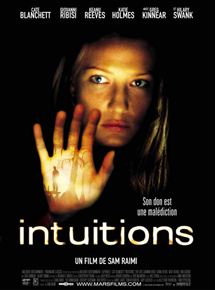Spoilers
Sharkploitation
Avec ce film, Spielberg allait créer le blockbuster estival. Il offre une passerelle entre le film catastrophe, le film d’aventures et le slasher movie (le requin jouant le rôle du tueur). La scène d’ouverture porte les thématiques du film. Un jeune y séduit une jeune fille. Celle-ci se déshabille et va se baigner. Le jeune homme, saoul, ne peut pas la rejoindre et crie « I’m coming », ce qui peut se traduire par « j’arrive », mais aussi par « je jouis »… La fille est attaquée par le requin, comme violée par celui-ci. Le jeune homme n’a rien vu et s’endort sur la plage.
La fille a répondu à l’appel du large (l’appel du sexe, de l’inconnu). Le requin est très symboliquement l’état entre l’âge adulte et l’enfance et il va falloir l’affronter. C’est ce qui va arriver à Brody (Roy Scheider), le flic du coin.
Plusieurs éléments étayent cette idée : quand il questionne le jeune homme après la noyade, il lui parle comme à un copain de lycée, il se heurte à l’autorité, il a l’impression qu’on ne l’écoute pas, et quand il prend une initiative (la fermeture des plages), il se retrouve puni. De même, quand il se documente sur les requins, il s’endort sur les cours, comme un étudiant.
Le film se démarque du roman pour pouvoir coller aux thématiques de Spielberg. Ainsi, la liaison entre Hooper et la femme de Brody disparaît, la femme chez lui n’étant quasiment pas un objet sexuel, revêtant plutôt les habits de la mère. Hooper (Richard Dreyfus) devient alors le bon copain de Brody, une espèce de geek avant l’heure.
Le passage de Brody à l’âge adulte se fait par petites touches. Il rencontre donc son pote Hooper, déraciné comme lui. Lors de la mort du fils Kitner, la mère lui ordonne, après l’avoir giflé, d’aller tuer le monstre, donc de se confronter au monde adulte, de tuer l’enfant en lui.
Sa femme lui parle souvent avec un ton très maternaliste, ce qui le met mal à l’aise surtout quand elle le fait en public. Tout comme le jeune s’est pris une cuite en début de film espérant se faire la fille sur la plage, Brody se saoule avant d’affronter la mer, l’âge adulte. Il repousse toujours le moment de cet affrontement. L’attaque contre son fils aîné rend celui-ci inéluctable.
Le film bascule en film d’aventures entre hommes (une des rares fois dans la carrière de Spielberg où la femme est mise à l’écart), ce qui est sûrement la conséquence de la présence au scénario de John Millius. Dans cette partie se trouve un des passages les plus emblématiques du film, et aussi un des plus flippants : la tirade de Quint (Robert Shaw) sur le drame de l’Indianapolis. Ce passage est là pour expliquer de manière efficace et rapide qui est Quint, le personnage le plus ambigu de ce film. Il est l’héritier de tout un pan de la littérature américaine (avec son assurance qui l’entraîne vers l’arrogance) et nous fait inévitablement penser à Achab , le chasseur du Moby Dick de Melville. Pour lui, il n’y a qu’une loi, celle de la nature, et jusqu’ici il la maîtrise. Ce qui le met en opposition frontale avec Brody qui lui représente la loi des hommes. Il va prendre la place de la figure paternelle, étouffant la figure maternelle et la repoussant aux yeux de Brody.
Il en arrive même à se fâcher avec Hooper lorsqu’il se rapproche de Quint. Hooper voit en lui un mec vantard. Tout ceci se passe lorsque le requin est caché. Dès que la bête ressurgit, Hooper reprend le dessus, Brody ne cherchant pas à prendre parti, restant dans le factuel (« We’ll need a bigger boat »).
Comme tout bon film d’aventure, on a ainsi un récit initiatique. Quint veut livrer bataille, mais pas au requin particulièrement. À la Nature en général, car il sent qu’il est en train de perdre la partie (il casse sa radio, coupant tout contact entre eux et le monde des hommes).
Ils sont trois, et représentent ainsi 3 phases : l’ado (Brody), le jeune adulte (Hooper), et l’adulte, le père (Quint). Et les trois se trompent sur la nature du mal qu’ils affrontent, du moins sur la manière de s’en protéger : Quint fait confiance à son bateau, Hooper à sa cage, et Brody aux deux autres hommes. Un meurt (l’adulte), un est blessé (le jeune adulte) et le troisième, l’enfant, doit affronter le mal en face, les yeux dans les yeux, pour le tuer. Pour repartir vers la maison enfin adulte.